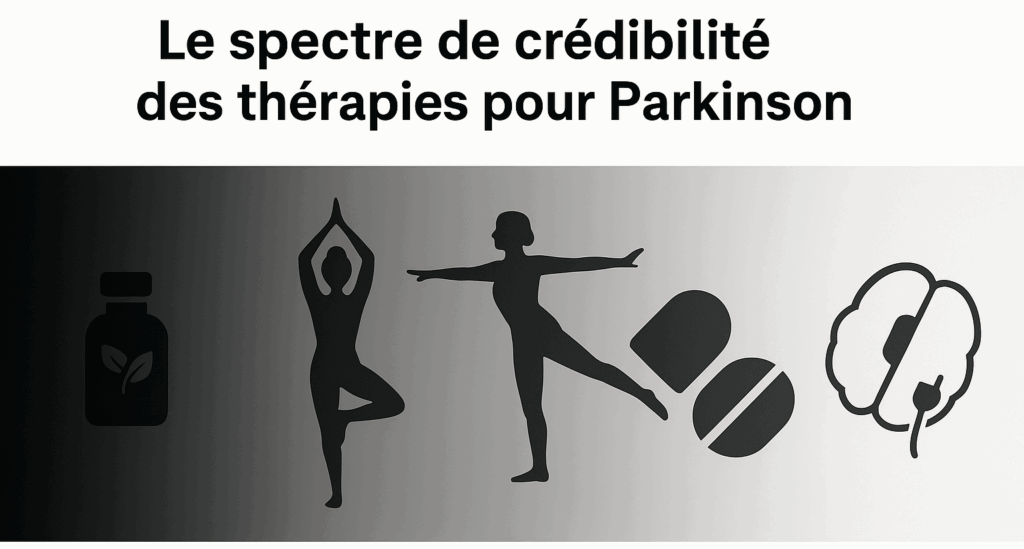🧠 Contexte et objectif
L’article, produit par le groupe de travail international sur le bien-être de la MDS (Movement Disorder Society), propose une “prescription de bien-être holistique” pour la maladie de Parkinson (MP) (https://movementdisorders.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mdc3.70381).
Cette approche repose sur le modèle biopsychosocial, plaçant la personne atteinte au centre du soin, et vise à intégrer les dimensions physiques, psychologiques, sociales, environnementales et spirituelles dans la prise en charge.
⚙️ Principes généraux
- Le bien-être est défini comme « la poursuite active de choix et de modes de vie menant à une santé globale ».
- L’objectif est de passer d’une médecine réactive à une médecine proactive et préventive.
- La prescription doit être accessible à tous, adaptée au contexte culturel et aux ressources locales, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
🩺 Les piliers de la “prescription de bien-être”
- Activité physique
- Recommandation : ≥150 minutes d’exercice aérobie modéré à intense par semaine, avec renforcement musculaire, équilibre et étirements.
- Les programmes efficaces incluent la danse, le tai-chi, le yoga, la boxe, la marche nordique, la natation, le Pilates.
- Bénéfices : amélioration des symptômes moteurs et non moteurs (sommeil, anxiété, cognition, douleur, constipation) et potentiellement ralentissement de la progression de la maladie.
- Nutrition
- Favoriser les régimes méditerranéen, MIND ou plant-based, riches en fruits, légumes, légumineuses, noix, poissons, huile d’olive.
- Éviter aliments ultra-transformés, viandes rouges et sucres ajoutés.
- Importance de l’hydratation et de la gestion des interactions protéines–lévodopa.
- Risques fréquents de malnutrition et de carences en vitamine D et B12.
- Sommeil
- Les troubles du sommeil sont fréquents (insomnie, somnolence diurne, troubles du rythme circadien).
- Gestion : hygiène du sommeil, activité physique, thérapie cognitivo-comportementale (TCC), exposition à la lumière naturelle, thérapie lumineuse.
- Santé mentale
- Le bien-être mental est central : prévenir anxiété, dépression, apathie, psychose.
- Interventions : dépistage régulier, TCC, méditation, relaxation, groupes de soutien et « prescriptions sociales ».
- Pratiques corps–esprit
- Yoga, méditation, tai chi, qigong : réduisent stress, anxiété, inflammation (diminution de l’IL-6), améliorent équilibre et humeur.
- Les interventions basées sur la pleine conscience (MBI/MBSR) montrent des effets bénéfiques durables sur la qualité de vie et la neuroplasticité.
- Engagement social et sens de la vie
- La solitude aggrave les symptômes et la qualité de vie.
- Trois niveaux de connexion sont essentiels : intime, sociale, collective.
- Favoriser les groupes de soutien, activités partagées, bénévolat, et encourager la participation à des activités ayant du sens et un but personnel.
- Santé sexuelle
- Aspect souvent négligé, pourtant crucial pour la qualité de vie.
- Nécessite une discussion ouverte et une approche interdisciplinaire.
- La sexualité contribue à la santé physique, mentale et émotionnelle.
- Santé générale et autogestion
- Importance de surveiller vue, audition, santé bucco-dentaire, osseuse et intestinale.
- L’outil “Chaudhuri-Mostyn Dashboard” aide à structurer un suivi global.
- L’autogestion renforce l’autonomie : éducation, outils numériques, programmes d’exercices et soutien émotionnel.
- Compétence culturelle et médecines traditionnelles
- Les approches comme l’Ayurveda (yoga, mucuna pruriens) et la médecine traditionnelle chinoise (acupuncture, tai chi, qigong) peuvent compléter la prise en charge, si intégrées avec respect et prudence scientifique.
🌍 Accessibilité et équité
- Le modèle souligne les inégalités mondiales d’accès aux soins neurologiques, notamment dans les pays à faible revenu.
- Le bien-être doit être perçu comme un droit humain fondamental, pas un luxe réservé aux pays riches.
- Les interventions doivent être faibles en coût, culturellement adaptées et centrées sur ce que chacun peut faire pour soi.
🧩 Conclusion
L’article appelle à une révolution du paradigme de soins dans la maladie de Parkinson : passer du traitement symptomatique à un modèle de bien-être global, où chaque patient devient acteur de sa santé.
Cette approche, fondée sur des preuves et adaptable à différents contextes, vise à préserver la qualité de vie, retarder la progression de la maladie et promouvoir la santé du cerveau à toutes les étapes du parcours de soin.